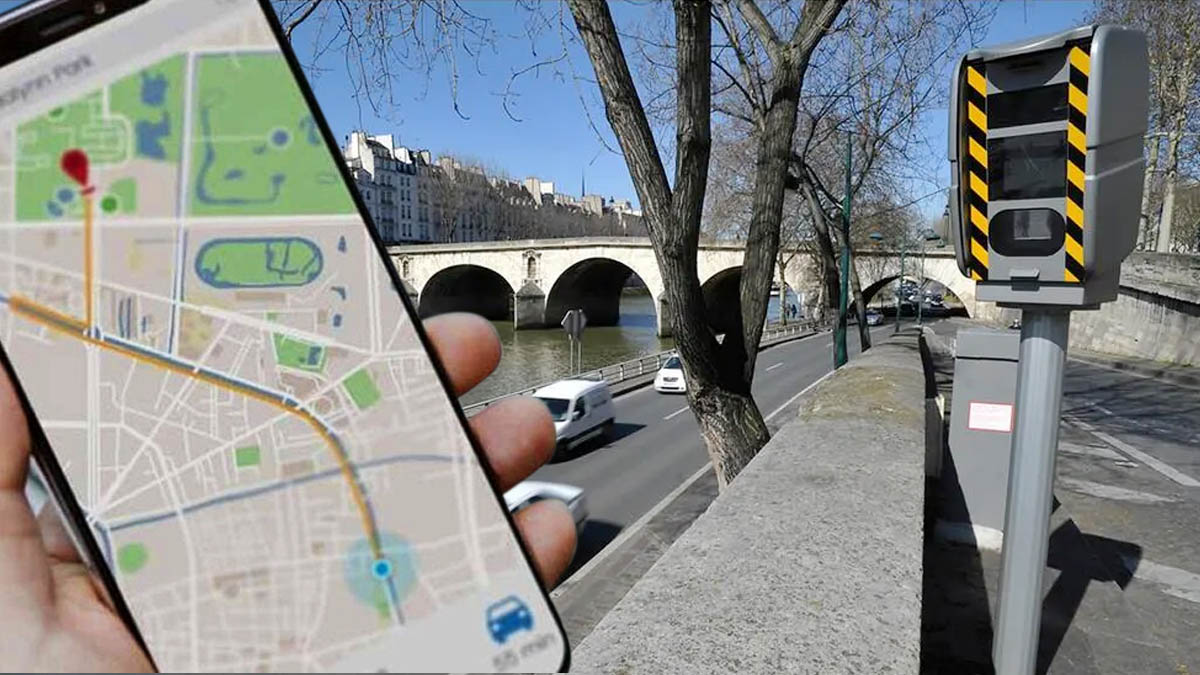En 2020, les retraités nés dans les années 1950 perçoivent une pension nettement plus confortable que ceux de la génération née dans les années 1930. À première vue, cette différence pourrait sembler évidente. Mais elle résulte en réalité de multiples facteurs sociaux, économiques et législatifs qui se combinent sur plusieurs décennies.
La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) a analysé ces écarts dans son rapport annuel publié le 31 juillet.
Tous régimes confondus, les pensions brutes de droit direct incluant d’éventuelles majorations pour trois enfants ou plus ont progressé en moyenne de 24 % entre les générations nées en 1930 et celles nées en 1953, après prise en compte de l’inflation.
Concrètement, les retraités les plus anciens vivaient avec environ 1 265 euros par mois contre 1 570 euros pour la génération 1953. Cet écart illustre l’évolution des carrières, des rémunérations et des régimes de retraite sur plusieurs décennies.
Une progression inégale selon les années de naissance
Si l’on regarde de plus près, l’augmentation des pensions n’est pas régulière. Entre la fin des années 1940 et le début des années 1950, on observe même un léger recul. Ainsi, les retraités nés en 1947 percevaient en moyenne 1 601 euros brut par mois, contre 1 570 euros pour la génération 1953.
Cette baisse s’explique par plusieurs facteurs liés aux réformes et aux contextes économiques successifs. La hausse des niveaux de qualification et des salaires a favorisé certaines générations. Cependant, des changements législatifs ont limité les augmentations pour d’autres cohortes.
Parmi ces mesures, la Drees cite :
- L’indexation des pensions de base sur les prix, mise en place depuis 1987 dans le secteur privé,
- L’écrêtement du minimum contributif depuis 2012,
- L’allongement de la durée de référence pour une carrière complète, fixé par les lois de 2003 et 2014,
- Les accords Agirc-Arcco, qui ont réduit le rendement des points dans les régimes complémentaires,
- Le gel du point d’indice dans la fonction publique, affectant directement les pensions des agents.
Ces éléments montrent que la génération 1953 ne bénéficie pas toujours d’une augmentation linéaire par rapport à celle née quelques années plus tôt.
La mortalité différentielle : un facteur clé
Pour comparer correctement les générations, la Drees utilise la notion de mortalité différentielle. Cette approche prend en compte l’espérance de vie qui varie selon les catégories sociales et économiques. Les retraités plus aisés vivent généralement plus longtemps et cela influence la durée totale passée en retraite et donc le montant moyen observé.
Sans cet ajustement, les retraités les plus anciens encore vivants à la fin 2020 ne représenteraient pas l’ensemble de leur génération. En d’autres termes, ignorer ce critère fausserait la lecture des écarts de pension.
Les facteurs structurels à l’origine de l’écart
Plusieurs éléments expliquent globalement pourquoi la génération 1953 perçoit une pension plus élevée :
- Des niveaux de qualification et de salaires plus élevés, favorisant une base de pension plus forte,
- Une diminution du non-salariat, plus fréquent chez les générations antérieures et associé à des pensions plus faibles,
- La montée progressive des régimes complémentaires pour les salariés dans les années 1970,
- Les réformes successives, ajustant règles de calcul, plafonds et indexations,
- Les politiques salariales dans la fonction publique, comme le gel du point d’indice.
Pour conculre, l’écart de 24 % entre les générations nées en 1930 et en 1953 reflète à la fois des évolutions économiques, sociales et législatives. Si les générations plus récentes bénéficient de pensions plus confortables, des variations persistent selon les cohortes et les métiers.
Comprendre ces différences permet de mieux appréhender la manière dont les carrières, les réformes et les choix professionnels façonnent aujourd’hui le montant des retraites en France.
Une lecture attentive de ces éléments éclaire les enjeux de justice intergénérationnelle et la nécessité d’adapter les systèmes de retraite aux réalités économiques et sociales. Cela invite également à réfléchir aux mesures futures pour garantir une équité durable entre toutes les générations de retraités.