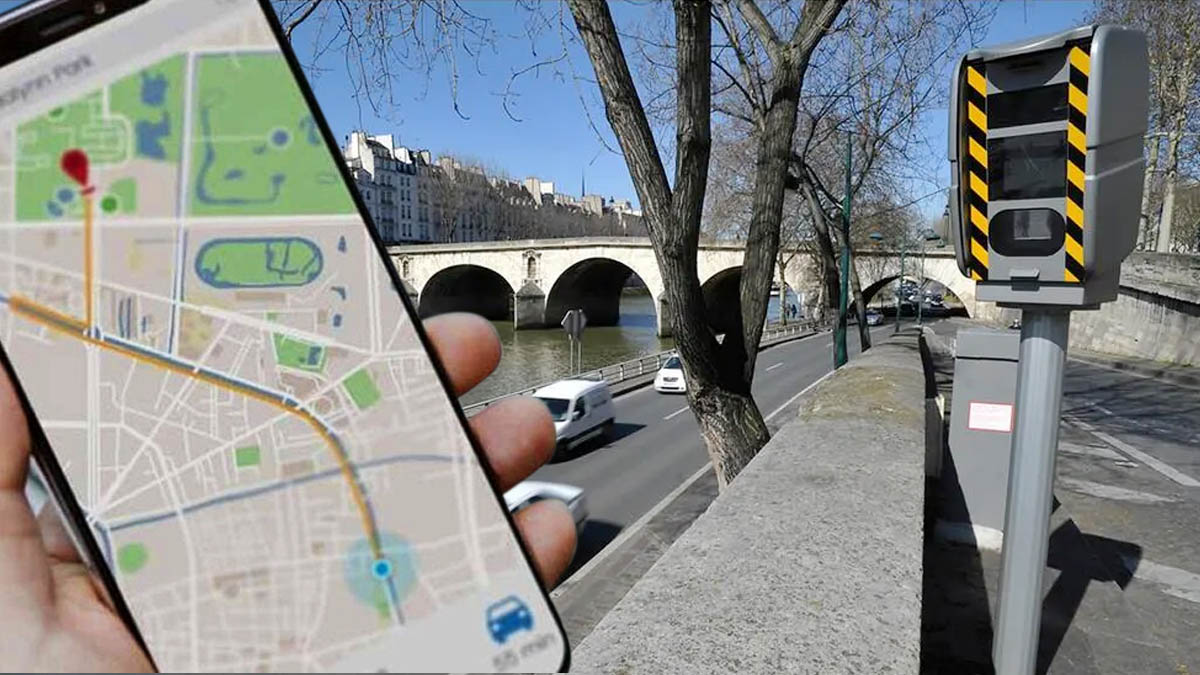Chaque automne, le changement d’heure fait son retour. Pour certains, c’est une bonne nouvelle : une heure de sommeil en plus n’est jamais de refus. Pour d’autres, c’est au contraire une contrainte perçue comme une habitude dépassée.
Entre satisfactions, débats récurrents et petites inquiétudes, ce rituel continue de marquer la vie des Français. En 2025, la date est déjà fixée. Voici ce qu’il faut retenir pour bien s’y préparer.
La date exacte du passage à l’heure d’hiver
Comme chaque année, c’est le dernier week-end d’octobre qui sert de repère. En 2025, le passage à l’heure d’hiver se fera dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 octobre. À 2 heures du matin, il faudra reculer toutes les horloges d’une heure : il sera alors obligatoirement 1 heure.
Ce décalage offre un temps de repos supplémentaire. Certains choisissent de prolonger leur nuit, d’autres profitent d’une soirée un peu plus longue. Mais si le gain paraît simple et agréable, il ne faut pas oublier que l’organisme doit se réajuster.
Un changement pas toujours anodin pour le corps
Reculer l’heure d’une soixantaine de minutes semble sans conséquence mais le corps fonctionne selon une horloge interne précise. Cette transition peut provoquer une fatigue passagère, des réveils nocturnes ou un léger décalage dans les habitudes quotidiennes.
La raison est simple : la mélatonine qui est l’hormone du sommeil se met à être produite plus tôt et cela modifie temporairement les cycles. Si la majorité des personnes s’adaptent rapidement, certains profils comme les enfants, les seniors ou les personnes sensibles peuvent avoir besoin de quelques jours pour retrouver un rythme stable.
Pourquoi conserver-t-on ce système ?
Le changement d’heure a été instauré en 1976 après le premier choc pétrolier. L’objectif était de réaliser des économies d’énergie en exploitant au mieux la lumière naturelle en soirée et en limitant l’usage de l’éclairage artificiel.
Avec le temps, l’utilité de cette mesure a été remise en question. En 2018, une grande consultation européenne a montré que 84 % des participants y étaient opposés. Plusieurs pays ont depuis décidé d’y renoncer.
Cependant, en France, la pratique reste en vigueur, faute d’accord commun au niveau européen. En conséquence, les horloges sont encore avancées ou reculées deux fois par an et les débats reviennent systématiquement.
Quels effets au quotidien ?
Si beaucoup accueillent ce décalage comme une opportunité de dormir davantage, d’autres remarquent plutôt ses effets secondaires. Une fatigue inhabituelle, une baisse de concentration, un appétit déréglé ou des difficultés d’endormissement peuvent apparaître.
La bonne nouvelle, c’est que ces désagréments ne durent pas. En général, quelques jours suffisent pour retrouver un rythme normal. L’important est de laisser au corps le temps de se réhabituer.
Conseils pratiques pour mieux s’adapter
Il est possible de réduire l’impact du changement d’heure avec quelques gestes simples.
- Anticiper : décaler progressivement ses horaires de sommeil et de repas dans les jours précédents faciliter l’ajustement.
- Privilégier la lumière naturelle : s’exposer au soleil le matin aide à resynchroniser l’horloge interne.
- Limiter les écrans avant le coucher : la lumière bleue perturbe l’endormissement.
- Préparer une soirée calme : un repas léger et une activité relaxante le samedi soir permettent une transition en douceur.
Entre tradition et avenir incertain
Au départ, le changement d’heure visait à réduire la consommation d’électricité. Aujourd’hui, beaucoup estiment que les bénéfices énergétiques sont minimes, tandis que les effets sur le sommeil et la santé restent visibles.
La France attend toujours une décision européenne pour trancher définitivement : maintenir ce système ou l’abandonner. En attendant, le rituel perdure et chacun s’y adapte à sa manière.